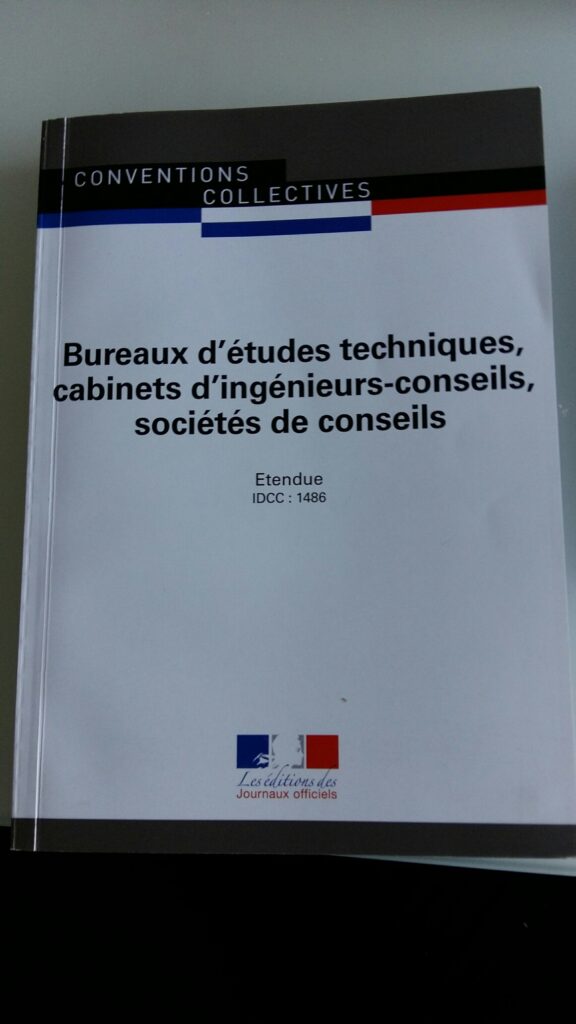Deux nouveaux accords de branche signés le 22 octobre 2025 : attention à leur portée
Deux textes importants ont été signés le 22 octobre 2025 au sein de la branche des bureaux d’études (IDCC 1486), à l’initiative des organisations patronales SYNTEC et CINOV, avec plusieurs organisations syndicales de salariés.
Point d’attention essentiel : ces deux accords ne sont pas encore étendus. Ils ne s’imposent donc pas automatiquement à toutes les entreprises de la branche.
1. Un accord de branche sur l’égalité professionnelle femmes-hommes
Le premier texte est un accord de branche relatif à l’égalité professionnelle. Il fixe un cadre global autour de plusieurs axes : réduction des écarts de rémunération, soutien aux carrières des femmes, mixité des métiers, transparence salariale et amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il s’inscrit clairement dans la continuité des obligations légales existantes et anticipe certaines évolutions à venir, notamment en matière de transparence des rémunérations.
accord-22-oct-2025-cc088
2. Un avenant consacré à la parentalité
Le second texte est l’avenant n°49, centré sur la parentalité. Il renforce les droits des salariés avant et après l’arrivée d’un enfant : grossesse, maternité, paternité, adoption, PMA ou allaitement.
On notera notamment l’amélioration de certains dispositifs d’indemnisation et la réécriture des congés pour événements familiaux. Là encore, ces dispositions ne produiront pleinement leurs effets qu’après extension.
avenant-49-22-oct-2025-cc088
Ce qu’il faut retenir pour les entreprises
Tant que l’extension n’est pas publiée au Journal officiel, ces textes ne sont obligatoires que pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.
Ils constituent néanmoins un signal fort et un outil d’anticipation utile pour les employeurs, en particulier sur les sujets sensibles de l’égalité professionnelle et de la parentalité.
Une vigilance particulière s’impose donc dans l’attente de leur éventuelle extension.