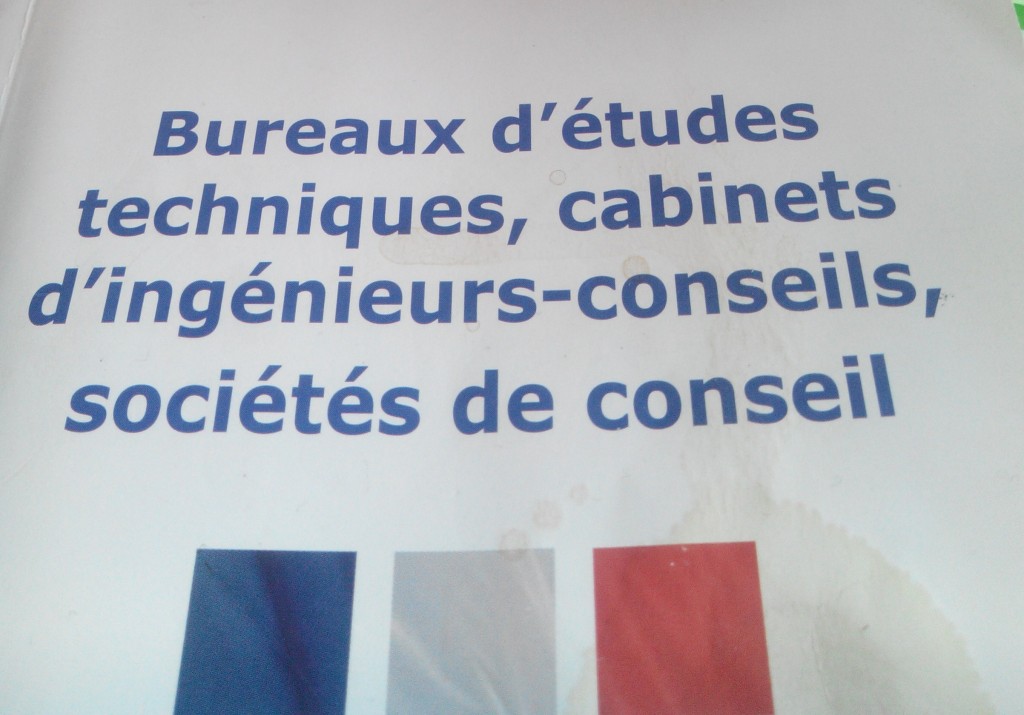Parmi les idées reçues, l’une des plus tenaces est de croire qu’un salarié ayant bénéficié d’un PSE serait illégitime à agir en justice.
Parfois, l’employeur va jusqu’à insérer dans le PSE une clause conditionnant le versement d’indemnités à l’absence de recours en justice.
Pourtant cette pratique est illégale et préjudiciable au salarié.
–> illégal car une telle clause est nulle et porte atteinte à une liberté fondamentale, le droit d’agir en justice.
–> préjudiciable car elle crée une pression injustifiée sur les salariés, ce qui constitue un préjudice ouvrant droit à réparation.
La Cour de cassation est claire sur cette question dans une affaire où un employeur avait tenté d’imposer cette contrainte à ses salariés. (Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-11033)
Pourtant l’employeur soutenait que la clause n’aurait pas été appliquée et n’aurait causé aucun préjudice.
La réponse de la Cour ?
Peu importe.
Son existence seule suffit à créer un préjudice indemnisable.
À retenir :
- Un salarié peut toujours contester son licenciement, même s’il a perçu des indemnités du PSE.
- Une clause qui vise à dissuader les salariés d’agir en justice est nulle et ouvre droit à des dommages et intérêts.
- Le droit d’agir en justice est un principe fondamental : aucun accord dans le cadre d’un plan social ne peut y porter atteinte.
Un bémol cependant : lorsque les indemnités versées dans le cadre d’un PSE sont élevées, les juridictions prud’homales ont tendance à être moins généreuses sur le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.