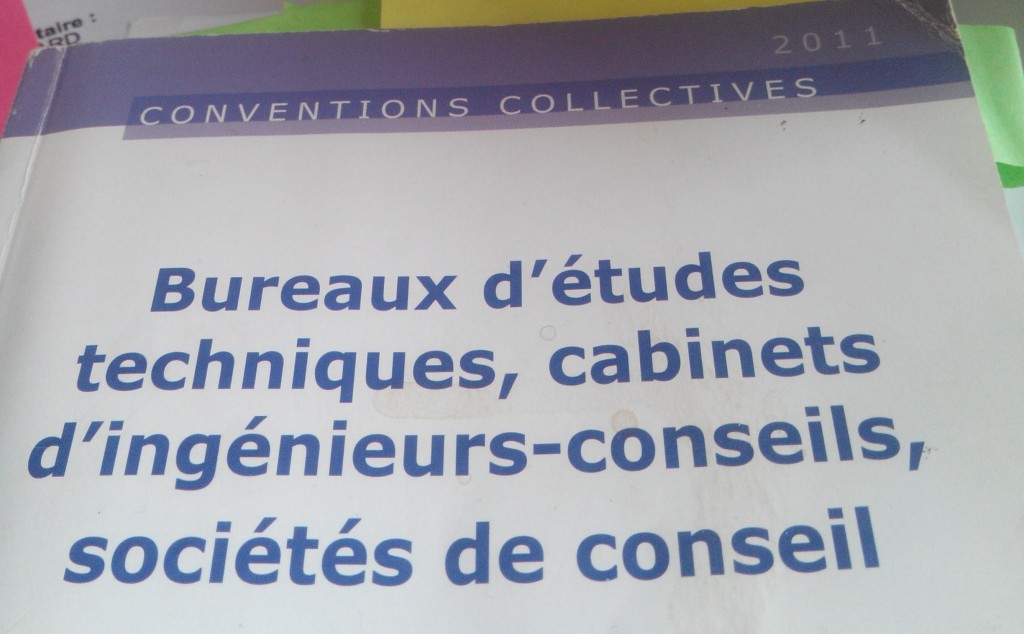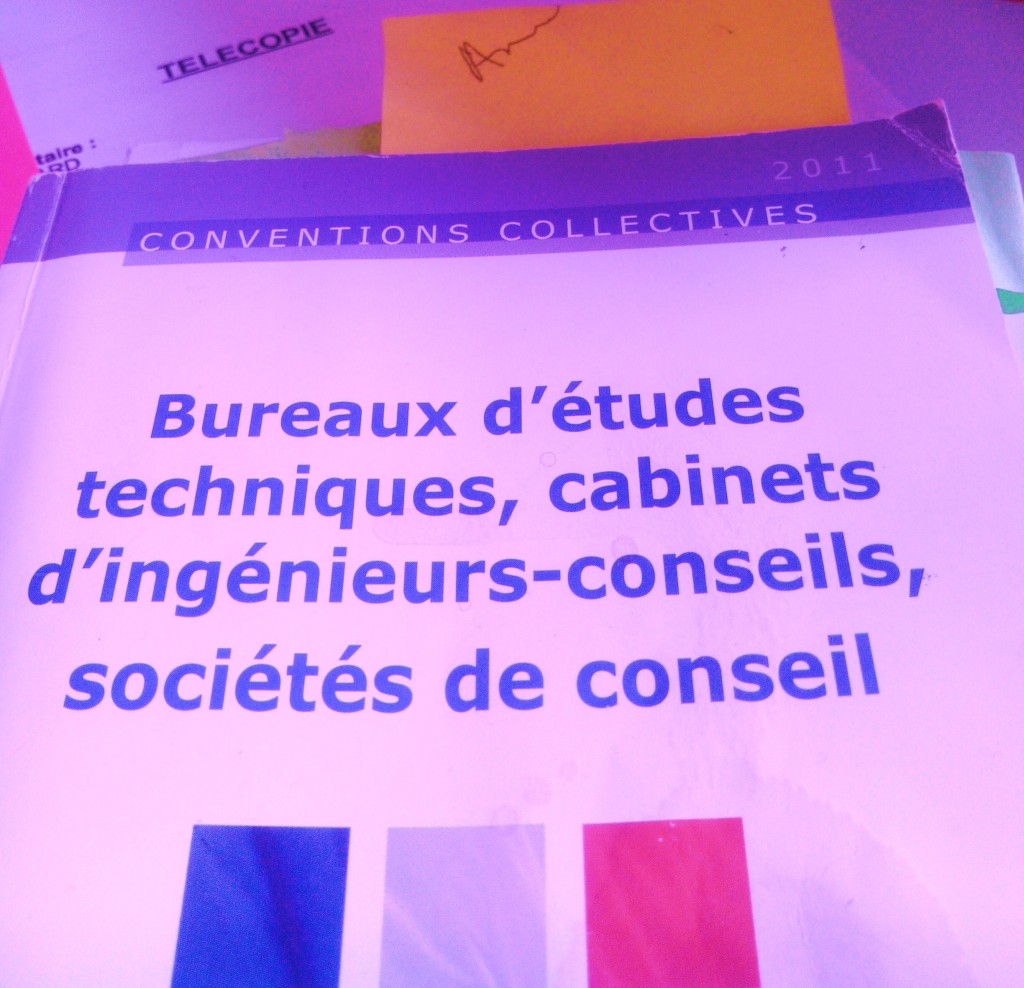Aucun texte légal n’ouvre un droit automatique à l’employeur de contrôler l’alcoolémie de ses salariés.
Pourtant l’état d’ébriété peut avoir de graves conséquences au travail.
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence admet qu’un règlement intérieur puisse prévoir que des salariés soient soumis à des mesures d’alcoolémie pour vérifier leur éventuel état d’ébriété sur le lieu de travail à la double condition que :
- Le règlement intérieur offre la possibilité pour le salarié contrôlé positif de demander une contre-expertise,
- L’éventuel état d’ébriété d’un salarié expose les personnes ou les biens à un danger compte tenu de la nature du travail confié aux salariés, et en cela constituer une faute grave.
Réaliser en conformité avec le règlement intérieur, l’éthylotest positif peut parfaitement fonder un licenciement.
La Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt récent que si le salarié veut contester le contrôle d’alcoolémie, il doit le faire rapidement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.460, Inédit)
Dans cette affaire, le licenciement du salarié était fondé sur un contrôle d’alcoolémie positif de 0,28 gramme par litre de sang réalisé conformément au règlement intérieur.
Le salarié n’avait pas sollicité immédiatement de contre-expertise mais avait demandé 12 jours plus tard à l’employeur de procéder à examen sanguin à titre de contre-expertise.
L’employeur avait refusé.
La Cour de cassation considère qu’il ne pouvait être tiré aucune conséquence du refus de l’employeur de faire procéder à cet examen biologique.
En effet, l’objet de la contre-expertise est de permettre au salarié de contester les résultats du contrôle d’alcoolémie, ce qui impose que le prélèvement sanguin soit réalisé dans le plus court délai possible.