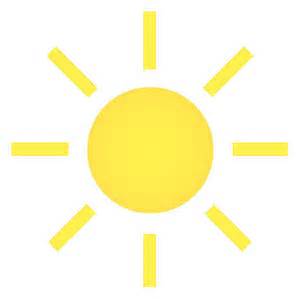Un nouveau dossier de discrimination salariale au sein de Canal + me donne l’occasion de rappeler l‘utilité de l’article 145 du code de procédure civile dans la preuve des discriminations notamment syndicales et salariales.
Un nouveau dossier de discrimination salariale au sein de Canal + me donne l’occasion de rappeler l‘utilité de l’article 145 du code de procédure civile dans la preuve des discriminations notamment syndicales et salariales.
Pour mémoire, cet article 145 du CPC permet de solliciter, en référé et avant toute procédure au fond, les pièces détenues par l’employeur qui prouverait une discrimination.
Voici le contenu de la décision de la Cour de Cassation du 22 septembre 2021 qui rappelle que l’employeur peut être condamné sous astreinte à transmettre les pièces sollicitées par le salarié. (22 septembre 2021, Cour de cassation, chambre sociale, Pourvoi n° 19-26.144)
« Vu l’article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile :
9. Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
10. Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
11. Pour débouter le salarié de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée contre la société, l’arrêt retient que, s’agissant de l’existence d’un motif légitime, si le 5 septembre 2016, la société Groupe Canal+ a transmis, par l’intermédiaire de son avocat, un tableau comparatif insuffisamment documenté et difficilement exploitable, elle a cependant communiqué avant l’audience prud’homale les fiches individuelles de dix salariés entrés entre 1994 et 1998 aux fonctions de technicien conseil et se trouvant dans une situation comparable à celle du salarié ainsi que l’extrait correspondant du registre unique du personnel, que ces documents sont certes anonymisés mais qu’ils mentionnent le numéro de matricule du salarié concerné, ce qui permet si besoin d’en vérifier l’authenticité. Il ajoute que les dix salariés du panel relèvent du même service et dépendent du même responsable hiérarchique, et que ces fiches indiquent l’âge du salarié, son niveau de formation à l’embauche, son ancienneté dans le groupe et dans le poste, l’historique de ses affectations et des postes occupés avec l’échelon correspondant, la liste des formations suivies, l’historique des salaires mensuels et annuels avec le motif de l’augmentation (augmentation générale ou individuelle, changement d’échelon), l’historique des primes versées, des rémunérations variables, des heures supplémentaires et majorées, des versements au titre de la participation et de l’intéressement. Il en conclut que le panel est assez large et que les fiches communiquées par l’employeur sont suffisamment complètes pour permettre au salarié de procéder à la comparaison souhaitée.
12. En statuant ainsi, sans rechercher, d’abord, si la communication des pièces demandées par le salarié n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et ensuite, si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
 Comme pour 2021, le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) ne va pas subir de hausse.
Comme pour 2021, le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) ne va pas subir de hausse.