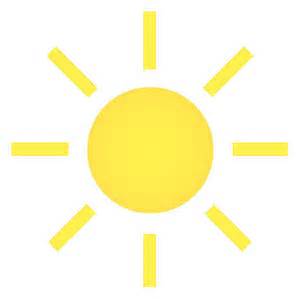Mis à jour le 29 octobre 2020
Mettre en place le télétravail est souvent plus simple que le salarié ou l’employeur ne le croit depuis janvier 2018.
Voici les possibilités offertes par la loi :
- un simple accord entre l’employeur et le salarié, par tout moyen (accord oral, courriel, courrier…) ;
- un accord collectif ;
- une charte élaborée par l’employeur, après avis du CSE (comité social et économique).
Même si nous conseillons toujours de rédiger un avenant avec le salarié en cas d’accord (sans accord collectif ou charte), rien n’oblige un tel formalisme : lettre, email etc restent valables.
Dans le cas où l’employeur préférera un accord collectif ou une charte, il faut rappeler que ces derniers devront préciser les points suivants :
- les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
- les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
- les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail.
Attention cependant, mettre en place le télétravail dans une entreprise ne s’improvise pas !
Il faut anticiper par exemple le possible coût de la mise en place ou encore réfléchir aux modifications qui concerneront nécessairement le management des équipes.
- organiser une concertation avec les services concernés : RH, service juridique, service informatique… ,
- définir les objectifs avec une équipe de représentants ;
- expérimenter pour mieux connaître les attentes des salariés ,
- évaluer le projet d’expérimentation et ajuster les objectifs.